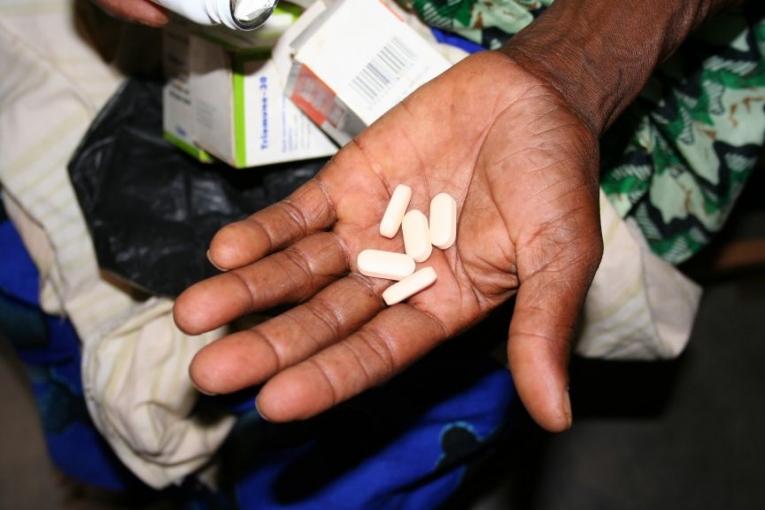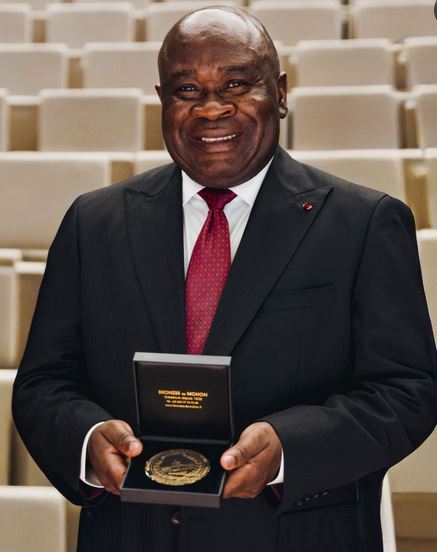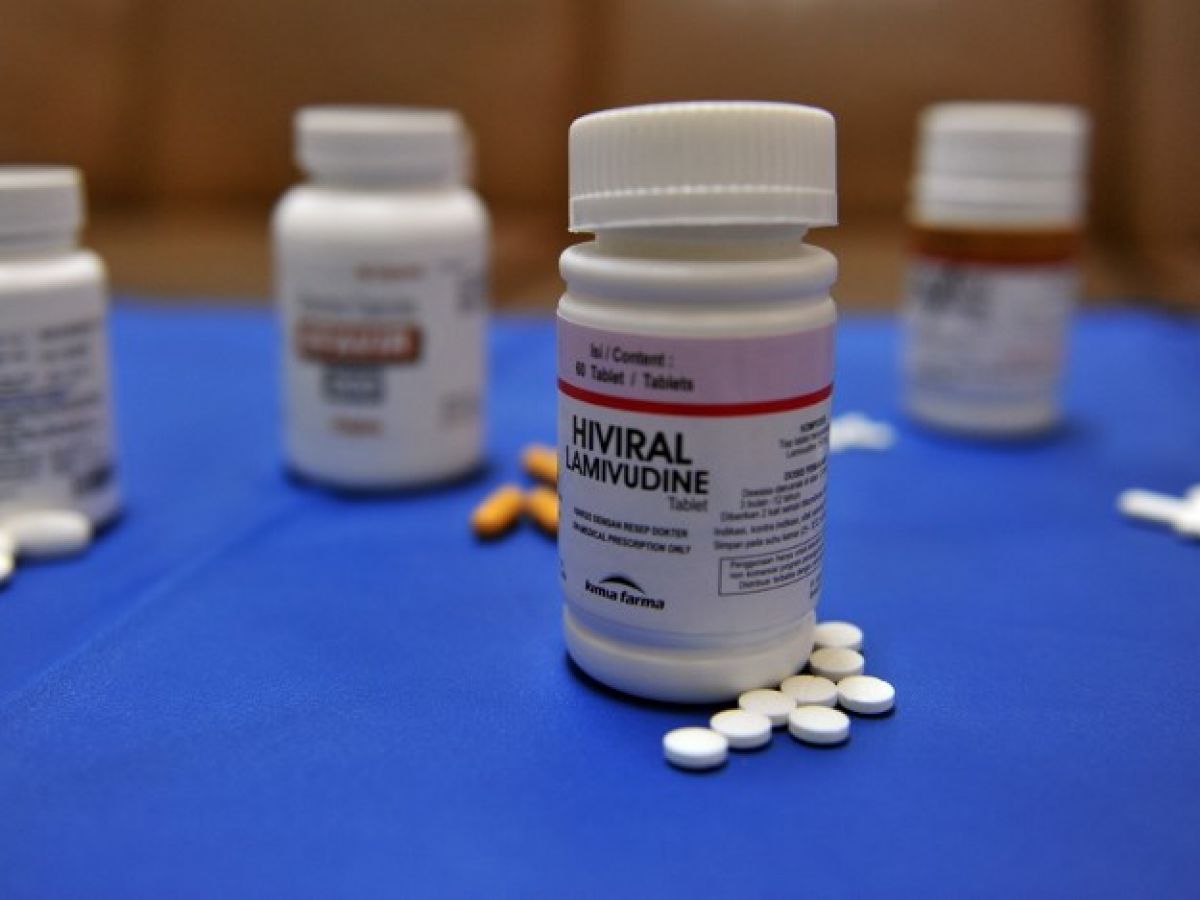Le ministre de l’Assainissement urbain, du Développement local et de l’Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a effectué, le 3 janvier, une descente sur le terrain dans plusieurs marchés domaniaux de Brazzaville, à l’occasion du premier samedi du mois.
Juste Désiré Mondelé pendant sa ronde a annoncé une réorganisation et une structuration des différentes taxes perçues dans ces espaces commerciaux.
« L’assainissement est l’affaire de tous. Il faut que chaque citoyen s’implique », a rappelé le ministre, précisant que le Conseil des ministres n’a pas institué de nouvelles taxes, mais a plutôt dressé un constat. « Il a été décidé de structurer les taxes existantes. Les associations qui gèrent les marchés éprouvent des difficultés à assurer leur propreté. À partir du 1er février, il ne devrait plus y avoir de tas d’immondices devant les marchés domaniaux », a-t-il averti.
Le ministre a également pointé du doigt le comportement de certains pousse-pousseurs et collecteurs d’ordures, accusés de transformer des artères de la capitale en dépotoirs, alors même qu’ils perçoivent des frais auprès des ménages. Il a, par ailleurs, dénoncé l’opacité entourant certaines taxes d’entretien prélevées quotidiennement dans des marchés tels que Ouenzé, Total et Poto-Poto, où une somme de 100 FCFA par jour est exigée sans que les montants collectés ne soient clairement établis.
« Ces marchés domaniaux disposent d’une autonomie de gestion, mais une taxe liée à l’assainissement existe bel et bien. La question est de savoir comment la structurer et la digitaliser afin qu’elle soit reversée à une structure organisée. Le but est de confier l’assainissement à des entreprises locales ou à des associations spécialisées », a expliqué Juste Désiré Mondelé, précisant que la société Albayrack n’a signé aucun contrat avec les marchés domaniaux.
Parmi les mesures annoncées figure également le recensement et l’identification des pré-collecteurs et collecteurs d’ordures, afin d’encadrer cette activité et d’avoir une meilleure visibilité sur les montants payés par les ménages. Cette opération sera suivie de l’immatriculation et de la répartition par blocs des ramasseurs d’ordures, lesquels devront impérativement déposer les déchets dans les Aires de transit des ordures ménagères (ATOM).
S’agissant du financement, Juste Désiré Mondelé a rappelé que la société Albayrack bénéficie d’un contrat avec les collectivités de Brazzaville et de Pointe-Noire, soutenu par l’État. La loi de finances 2026 a d’ailleurs prévu des mécanismes spécifiques, notamment le transfert de fonds, pour garantir la pérennité du ramassage des ordures ménagères.
Cette descente sur le terrain du membre du gouvernement fait suite à l’instruction du président de la République, Denis Sassou N’Guesso, lors du Conseil des ministres du 31 décembre dernier, de mettre en place, en concertation avec les collectivités locales concernées, une contribution citoyenne dédiée au ramassage des ordures, en complément du financement de l’État. L’objectif affiché est de mobiliser l’ensemble de la société congolaise autour de l’amélioration durable du cadre de vie.