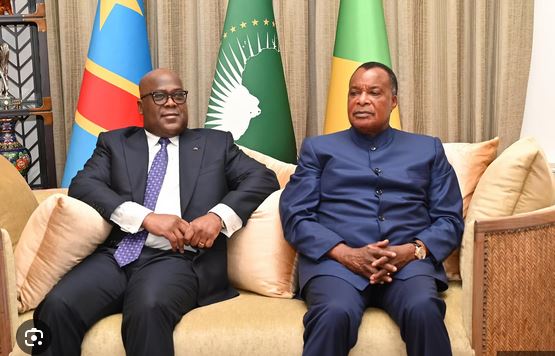L’annonce a été faite dans une note signée par le conseiller spécial, directeur général de la sécurité présidentielle, le général de brigade Serges Oboa.
La consigne instaurée au quartier des troupes de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) a été officiellement levée à compter du 27 janvier. Décrétée le 12 janvier dernier, cette mesure visait à permettre la conduite efficace des opérations militaires engagées dans le département du Pool et ses environs, dans le cadre de la lutte contre les rebelles ninjas et le grand banditisme.
Pour rappel, le dimanche 11 janvier, des échanges de tirs avaient éclaté dans la périphérie du district de Mindouli, opposant un convoi de la DGSP à un groupe de ninjas, présentés comme des miliciens « démobilisés » proches de Frédéric Bintsamou, alias Ntoumi. Ces affrontements avaient malheureusement occasionné des pertes en vies humaines.
Dans le prolongement de ces événements, et alors qu’elle se rendait à Pointe-Noire dans le cadre de l’opération « Zéro kulunas », lancée depuis plusieurs mois, la DGSP avait mené des actions dissuasives sur son passage. À Ngamadzambala, à l’entrée de la localité de Mayama, sur la Route nationale n°1, deux motocyclettes en situation irrégulière avaient été incendiées. Ces « deux roues » non enregistrées sont régulièrement soupçonnées d’être utilisées à des fins criminelles ou de soutien au grand banditisme.
À la suite de ces incidents, le dispositif sécuritaire avait été considérablement renforcé dans la zone, avec, selon plusieurs sources concordantes, le déploiement d’unités de la DGSP appuyées par une opération héliportée durant le week-end, visant à débusquer les éléments rebelles retranchés.
La levée de la consigne traduit aujourd’hui un retour progressif au calme dans le département du Pool. Les autorités rassurent que la situation sécuritaire est désormais sous contrôle.