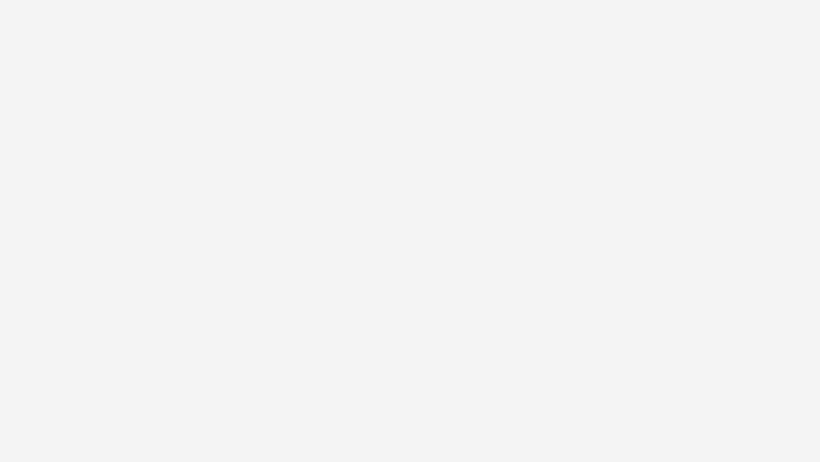Le développement de l’aquaculture au Congo fait face à un obstacle de taille : l’accès au financement. Pour répondre à ce défi, une formation dédiée à la mobilisation de fonds et à la gestion de projets aquacoles s’est ouverte le 11 juin à Brazzaville, réunissant une trentaine de participants.
Considérée comme un levier de lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, l’aquaculture représente également une source importante de protéines pour les populations. Selon la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), cette filière contribue au développement économique des zones rurales grâce à la création d’emplois et à une exploitation durable des ressources aquatiques. Dans cette optique, l’organisation soutient le Projet d’appui au développement de l’aquaculture commerciale, destiné à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Congo.
Le séminaire en cours, intitulé Atelier national de renforcement des capacités pour la promotion des investissements aquacoles, vise à former les producteurs sur la viabilité économique de leurs activités et la mise en place de plans d’affaires solides. Pendant trois jours, des opérateurs aquacoles, des représentants d’administrations, d’institutions de formation, de centres de recherche et de partenaires au développement se réunissent pour échanger leurs expériences et approfondir leurs compétences.
Dademanao Pissang Tchangaï, représentant résident de la FAO au Congo, a souligné l’importance de cette initiative : « Il s’agit d’aider les acteurs du secteur à concevoir des projets bancables en s’appuyant sur des outils d’analyse de rentabilité et de gestion financière. »
Parmi ces outils figure Utida, une application développée par la FAO pour évaluer les investissements aquacoles et structurer des plans d’affaires efficaces. Les participants bénéficient également des enseignements tirés d’une récente étude de cartographie, identifiant les zones du pays à fort potentiel aquacole, afin d’orienter au mieux les futurs investissements.
Lors de l’ouverture de la session, Pascal Robin Ongoka, directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, a rappelé les freins majeurs au développement du secteur : manque d’accès au crédit, déficit de compétences techniques, absence de données fiables, et structuration encore fragile. « Il est essentiel de former nos jeunes, nos entrepreneurs et les porteurs de projets pour attirer davantage d’investissements publics et privés », a-t-il insisté.
Cette formation se distingue par une approche pratique, permettant aux participants de manipuler directement l’outil Utida. Les travaux couvrent l’ensemble des aspects financiers d’un projet aquacole : facteurs influençant la rentabilité, estimation des revenus, gestion des coûts et bénéfices, mais aussi lecture et élaboration de documents comptables tels que le compte de résultats, les flux de trésorerie ou encore le bilan.