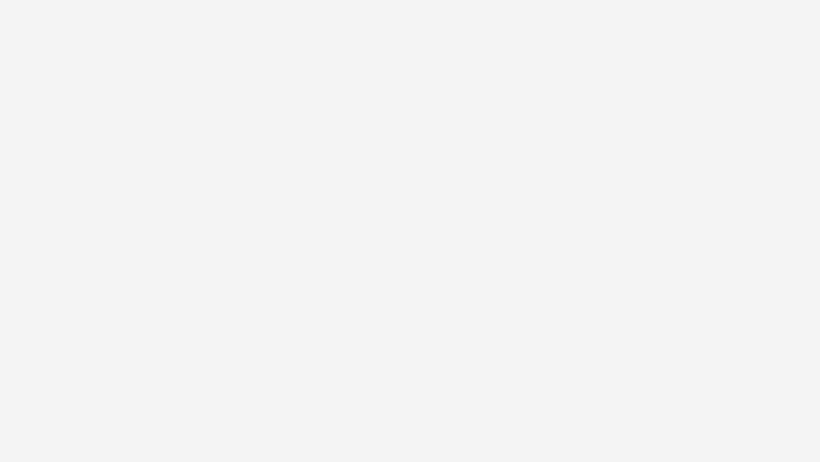La BEAC table sur une croissance modérée de 2,6% en 2025 dans la Cémac, marquée par le recul du secteur pétrolier malgré une légère reprise du non-pétrolier.
La Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) prévoit une croissance économique de 2,6% en 2025 dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac). Cette prévision, annoncée le 29 septembre par le gouverneur Yvon Sana Bangui lors d’une conférence de presse en ligne, marque un léger recul par rapport aux 2,7% enregistrés en 2024.
Selon les experts réunis à l’occasion de la troisième session du Comité de politique monétaire, ce ralentissement s’explique principalement par la baisse des activités pétrolières et gazières, malgré une progression du secteur non pétrolier estimée à 3,2% en 2025.
La BEAC note toutefois une atténuation de l’inflation, qui devrait s’établir à 2,6% en 2025, contre 4,1% l’an dernier. En revanche, la situation budgétaire se dégrade : le solde budgétaire passerait de -1% du PIB en 2024 à -1,3% en 2025, tandis que le déficit du compte courant atteindrait 2,2% du PIB.
Les réserves de change de la sous-région devraient également baisser, passant de 7 101,7 milliards FCFA fin 2025 à un niveau représentant 4,59 mois d’importations, contre 4,82 mois en 2024. Entre juin et août 2025, elles ont connu une tendance particulièrement baissière, avec un taux de couverture extérieure de la monnaie tombé à 61,6% au 31 août.
Pour soutenir la stabilité monétaire, la BEAC a décidé de maintenir ses principaux taux : taux d’intérêt des appels d’offres : 4,50% ; facilité de prêt marginal : 6,00% ; facilité de dépôt : 0,00% ; réserves obligatoires : 7% sur les dépôts à vue et 4,5% sur les dépôts à terme
Ces prévisions s’inscrivent dans un environnement international marqué par un léger ralentissement. D’après les données du FMI, la croissance mondiale devrait s’établir à 3,0% en 2025, contre 3,3% en 2024, avant de remonter légèrement à 3,1% en 2026.